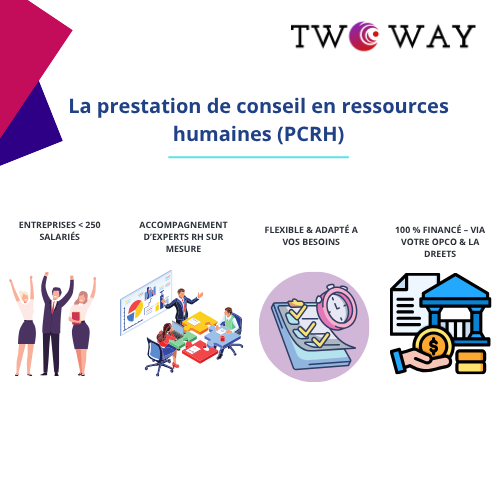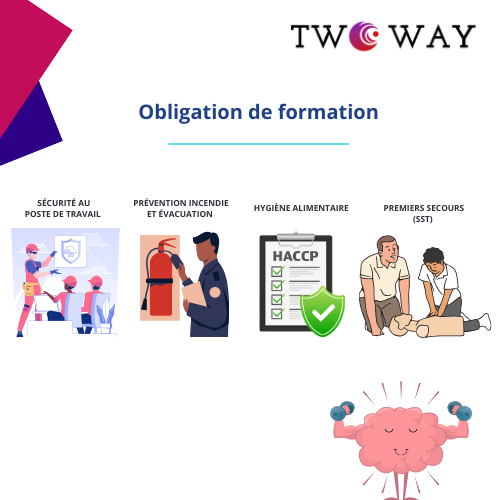Refus d’un CDI après un CDD : obligations, conséquences et bonnes pratiques pour les employeurs
.
La gestion de la fin d’un CDD constitue un enjeu juridique et RH important pour les entreprises. Depuis la loi « Marché du Travail » du 21 décembre 2022, renforcée par le décret du 28 décembre 2023, le refus par un salarié d’une proposition de CDI ne se limite plus à une simple décision individuelle : il entraîne désormais des conséquences directes, tant sur les droits du salarié que sur les obligations de l’employeur. Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont récemment confirmé et précisé ce régime.
.
1. Le cadre légal posé par la loi Marché du Travail
L’article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 prévoit que France Travail peut supprimer les droits à l’allocation chômage d’un demandeur d’emploi qui refuse à deux reprises sur les 12 derniers mois une proposition de CDI formulée à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim.
Pour que ce refus entraîne des conséquences, l’offre de CDI doit respecter plusieurs conditions :
-
-
- Concerner le même emploi ou un emploi similaire ;
- Proposer une rémunération équivalente, une durée de travail identique et une classification comparable ;
- Ne pas entraîner de changement du lieu de travail ;
- Être formulée par écrit avant l’échéance du contrat.
-
Depuis le 1er janvier 2024, l’employeur est tenu de formaliser cette proposition par écrit et de conserver une preuve de sa transmission. En cas de refus (exprès ou tacite), il doit en informer France Travail dans le délai d’un mois, par voie dématérialisée.
.
2. La validation du dispositif par le Conseil d’État
Saisi par plusieurs organisations syndicales, le Conseil d’État a confirmé, dans une décision du 18 juillet 2025 (n° 492244), la conformité du dispositif aux principes constitutionnels et européens.
Les syndicats invoquaient notamment :
- Un risque de travail forcé,
- Une atteinte au droit à l’assurance chômage,
- L’absence de délai minimal laissé au salarié pour se prononcer.
Le Conseil d’État a rejeté ces arguments en rappelant que :
- L’employeur doit laisser au salarié un délai raisonnable de réflexion,
- L’absence de réponse dans ce délai vaut refus tacite,
- France Travail a l’obligation d’informer le salarié des conséquences de son refus sur ses droits.
Cette décision confirme donc la légalité du dispositif et sécurise sa mise en œuvre par les employeurs.
.
3. Obligations de l’employeur issues du décret du 28 décembre 2023
Le décret n° 2023-1307 du 28 décembre 2023 est venu préciser les modalités pratiques de notification et de suivi des propositions de CDI.
Concrètement, l’employeur doit :
-
- Notifier la proposition de CDI par un moyen donnant date certaine (LRAR, remise en main propre contre décharge, ou tout procédé électronique sécurisé) ;
- Accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer, en l’informant que son silence vaudra refus ;
- Informer France Travail, dans le délai d’un mois suivant le refus exprès ou tacite, par voie dématérialisée ;
- Transmettre un descriptif détaillé de l’emploi proposé (emploi identique ou similaire, rémunération équivalente, durée et classification identiques, lieu de travail identique) ;
- Préciser le délai laissé au salarié pour répondre, ainsi que la date de refus exprès ou tacite.
En cas d’informations incomplètes, France Travail peut demander des précisions complémentaires à l’employeur, qui dispose alors de 15 jours pour y répondre.
.
4. L’indemnité de précarité en cas de refus de CDI
Pour l’employeur, le principal enjeu réside dans la traçabilité de la proposition. L’offre doit être suffisamment claire et documentée pour prouver qu’elle respecte les conditions légales.
En cas de refus du CDI conforme, l’article L. 1243-10 du Code du travail prévoit que l’indemnité de précarité n’est pas due. Cette prime, normalement fixée à 10 % de la rémunération brute totale perçue pendant le CDD, vise à compenser l’incertitude du contrat temporaire. Mais la jurisprudence a confirmé qu’elle disparaît dès lors qu’un CDI valable a été proposé et refusé.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2025 (n° 23-12.340), a rappelé que peu importe que le salarié ait exprimé avant la fin du contrat son souhait de ne pas poursuivre la relation de travail : l’offre de CDI suffit à exonérer l’employeur du versement de la prime de précarité.
.
5. Conséquences pour le salarié : perte des droits au chômage
Pour le salarié, le refus répété d’un CDI entraîne une double conséquence :
-
- Perte de l’indemnité de précarité à la fin du CDD ;
- Suppression des allocations chômage si, sur les 12 derniers mois, deux propositions équivalentes ont été refusées.
Cette sanction ne s’applique pas si le salarié a retrouvé un CDI au cours de la même période. L’objectif du législateur est de limiter le recours récurrent aux contrats courts et d’encourager la stabilité professionnelle.
Pour une vision synthétique et illustrée de ce dispositif, vous pouvez consulter l’infographie publiée par le ministère du Travail.
.
6. Bonnes pratiques pour sécuriser la gestion RH
Pour limiter les risques et sécuriser la procédure, il est recommandé aux employeurs de :
-
-
- Formaliser systématiquement par écrit la proposition de CDI, avec un maximum de précisions (poste, classification, rémunération, lieu) ;
- Accorder un délai clair et raisonnable de réflexion, en précisant que l’absence de réponse vaut refus ;
- Tracer les échanges et conserver toutes les preuves (copie de l’offre, preuve de réception, accusés de transmission à France Travail) ;
- Informer le salarié des conséquences possibles, même si France Travail en reste le garant ;
-
.
Conclusion : rigueur et anticipation pour une pratique sécurisée
Le refus d’un CDI à l’issue d’un CDD est désormais encadré par un régime juridique précis, qui produit des effets majeurs : perte de la prime de précarité et, à terme, suppression des droits au chômage. Pour les employeurs, il s’agit avant tout d’une obligation de rigueur et de traçabilité.
Bien formaliser les propositions, respecter les délais et anticiper la transmission des informations à France Travail permet de sécuriser vos pratiques et d’éviter tout contentieux.
Notre cabinet TWO WAY peut vous accompagner dans la mise en œuvre de ces formalités afin de garantir la conformité juridique et la sérénité dans vos relations de travail.